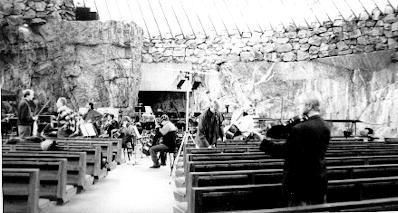|
La musique est la source, inspiratrice des mots.
Les Lettres de Musique, qu'est-ce que c'est? Les Lettres de Musique sont des textes inspirés par la musique, en l'occurrence des symphonies. Ils sont proposés à l'amateur de musique pour lui faire découvrir une œuvre musicale, ou lui offrir une opportunité de la vivre différemment. Si le texte peut, par sa concision, être considéré comme poétique, cette nature poétique est le fruit du rythme et de l'atmosphère évocatrice de l'oeuvre musicale, telle que celle-ci a été traduite par le chef et son orchestre. Les Lettres de Musique laissent à la musique son rôle premier. Les mots, pour autant qu'ils puissent être lus en écoutant la musique, invitent à prêter l'oreille. La musique est source, le texte la sert en veillant à respecter son contexte historique et biographique.
Les Lettres de Musique telles qu'elles sont présentées ici ne permettent que très partiellement une lecture synchronisée des textes avec la musique, à l'occasion des quelques extraits disponibles. Qu'à cela ne tienne, les Lettres peuvent être lues séparément de la musique, et s'apprécier par elles-mêmes.
Origine des Lettres de Musique L'idée des Lettres de Musique remonte à une expérience musicale au collège dans les années 1980, où la professeure de musique avait demandé à ses élèves de représenter en dessin la musique symphonique qui leur était donnée à écouter. Au fur et à mesure de l'écoute, la professeure indiquait les différentes sections de l'oeuvre, guidant ainsi les apprentis auditeurs-dessinateurs à travers l'oeuvre. Environ dix ans plus tard, le désir de l'auteur de faire partager sa fascination pour des symphonies qui lui paraissaient particulièrement remarquables, l'a amené à concevoir l'idée des Lettres de Musique. Depuis, celles-ci ont attiré l'attention et l'amitié de plusieurs personnalités du monde de la musique. Le chef d'orchestre M. Lawrence Forster, alors qu'il dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en 1995, a contacté l'auteur pour lui faire part qu'il était intéressé par un tel concept, sans l'avoir réalisé jusqu'alors. En 2003, ce projet ne semblait pas avoir vu le jour. Les Lettres de la Huitième Symphonie, d'après la Huitième Symphonie de Chostakovitch ont été publiées en anglais en 1997 dans le numéro 7 du DSCH Journal, sous l'intitulé "Music with Subtitles" avec l'accord de M. Emmanuel Utwiller, animateur du Centre Dimitri Chostakovitch. Peu après, sur une suggestion d'Alan Mercer, éditeur du DSCH Journal, le titre anglais allait devenir "Music in Words". Le titre français "Musique sous-titrée", allait suivre une évolution parallèle, bien que plus tardive, pour devenir "Lettres de Musique" en 2003. La même année, M. Yves Riesel, alors en charge du label Naxos France et aujourd'hui à la tête du dynamique distributeur Abeille Musique, avait rencontré l'auteur afin d'imaginer une application commerciale à un tel concept. Mais il fallut bien se rendre à l'évidence : demander à l'auditeur de suivre un texte tout en scrutant le minutage affiché sur son lecteur de disque compact n'était pas réaliste commercialement. Les Lettres de la Septième Symphonie, d'après la Septième Symphonie d'Allan Pettersson ont reçu en 1998 le soutien chaleureux de l'Association française Carl-Nielsen, présidée par M. Jean-Luc Caron. En février 2002, ce site a été distingué par le Site Hector Berlioz parmi ses recommandations de sites sur la musique, tandis que l'auteur était approché par la Musée de la Civilisation du Québec dans sa phase de préparation d'une exposition sur la musique symphonique. En 2003, la "Musique sous-titrée" s'est transformée en "Lettres de Musique", afin de mieux traduire la nature plus littéraire que littérale de ce projet. En 2005, Jacques Schmitt, correspondant musical pour la presse suisse, a manifesté son enthousiasme pour les Lettres de la Huitième Symphonie, à la suite d'un concert où il avait découvert cette Symphonie dirigée par Bernard Haitink.
Considérations plus générales sur les relations entre texte et musique Un texte peut être lu simultanément ou séparément de la musique Quand le texte qui accompagne une musique n'est pas récité ou chanté en même temps que la musique, il s'agit alors d'un programme ou d'une analyse musicale à lire avant, pendant ou auprès l'audition de l'œuvre, mais pas "en même temps". Les Lettres de Musique proposent simplement de lire le texte séparément de la musique, de manière traditionnelle, soit, et ce serait plus original, en même temps que la musique. Quand musique et parole sont simultanées, laquelle sert l'autre ? Il est difficile de donner une réponse tranchée, car cela dépend de la motivation du public, et de l'importance que celui-ci attribue au texte qu'il écoute. La romance la plus banale est capable de revêtir pour certaines personnes la valeur d'un texte sacré, et Marcel Proust lui-même a fait à raison l'éloge de la mauvaise musique. Inversement, un genre mal considéré comme la musique dite "de film" peut égaler l'objet qu'elle illustre, comme c'est le cas pour Sergueï Prokofiev avec Alexandre Nevski (S. Eisenstein, 1938), ou pour Bertnard Herrmann avec Psychose (A. Hitchcock, 1960). L'Association Internationale Dimitri Chostakovitch a organisé un très beau concert le 16 avril 2003, qui permettait de voir Odna, film de Kozintsev & Trauberg de 1931 sur une musique - reconstituée récemment, l'oeuvre n'ayant pas été éditée à l'époque - de Chostakovitch, jouée devant le public par les choeurs et l'orchestre du Conservatoire d'Amsterdam sous la direction de Marc Fitz-Gerald. Le film est superbe, mais la 6ème partie du film - qui en compte 7 - est manquante. Pendant la partie manquant, les spectateurs ont pu suivre alors les évènements en lisant à l'écran le déroulé de l'action. Malheureusement, le texte n'était pas synchronisé à la musique, alors même qu'il la décrivait. La présentation anglaise succédant à la présentation française, on put constater que lorsque le texte ne correspondait pas à la musique, il en résultait une distorsion qui rendait, au choix, le texte difficile à suivre ou la musique pénible à entendre. Au contraire, lorsque le texte collait, par accident, à la musique, oeil et oreille parvenaient à suivre harmonieusement l'un et l'autre, sans que l'image n'absorbe l'attention du spectateur au détriment de la musique. Musique descriptive contre musique pure, un sujet inutilement controversé depuis Berlioz Depuis au moins le 19e siècle, la musique instrumentale européenne est divisée entre musique descriptive et musique abstraite, appelée aussi et assez curieusement, musique "pure". Dans la première catégorie l'archétype populaire est certainement la Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz. Au 20e siècle, Igor Stravinski fut un des chantres les plus marquants de la musique pure. Pour lui l'émotion ne venait pas du sentimental, du tragique (du "pathos" pour être plus précis), mais de la qualité propre de la musique, de sa construction, des relations qui la sous-tendent. Mais au fond, après deux siècles de vifs débats, il convient de ne pas opposer trop brutalement ces deux musiques. Comme la musique pure, la musique descriptive est conditionnée par le compositeur et son époque, avec simplement un caractère narratif revendiqué par le compositeur de la musique à programme, mais qui ne modifie pas fondamentalement sa perception par l'auditeur. David Cairns, auteur d'une splendide biographie sur Berlioz, fait partie de ceux qui soutiennent cette position, et sa courte analyse sur ce sujet polémique est particulièrement éclairante. Berlioz lui-même a d'ailleurs évolué dans l'importance qu'il accordait au programme de sa Symphonie Fantastique. Au fur et à mesure que la Symphonie s'imposait dans les programmes des concerts, que son caractère nouveau et difficile s'estompait, le programme était visiblement ressenti par le compositeur comme moins essentiel. Ainsi, en 1845, 15 ans après la composition de la Symphonie, il reproduisait l'avertissement suivant : "Le compositeur a eu pour but de développer, dans ce qu’elles ont de musical, différentes situations de la vie d’un artiste. Le plan du drame instrumental, privé du secours de la parole, a besoin d’être exposé d’avance. Le programme* suivant doit donc être considéré comme le texte parlé d’un opéra, servant à amener des morceaux de musique, dont il motive le caractère et l’expression. *La distribution de ce programme à l’auditoire, dans les concerts où figure cette symphonie, est indispensable à l’intelligence complète du plan dramatique de l’ouvrage. [HB]" En 1855, Berlioz prend de la distance "Si on exécute la symphonie isolément dans un concert (...) on peut même à la rigueur se dispenser de distribuer le programme, en conservant seulement le titre des cinq morceaux; la symphonie (l’auteur l’espère) pouvant offrir en soi un intérêt musical indépendant de toute intention dramatique." Pour Berlioz, déjà, le débat de la musique pure "contre" la musique descriptive n'était plus essentiel.
Il est Secrétaire Général de l'association ResMusica.net, qui publie le site d'information ResMusica.com consacré à la musique classique et la danse, et de la Société Wilhelm Furtwängler. Rédacteur de ResMusica, il s'attache avec Jean-Luc Caron à y commenter l'actualité d'Allan Pettersson. Pour le reste, Jean-Christophe Le Toquin poursuit une carrière juridique et réglementaire liées aux problématiques Internet pour lesquelles il se passionne depuis qu'il a participé à la fondation d'un fournisseur d'accès au sein d'un grand groupe de médias en 1996.
|